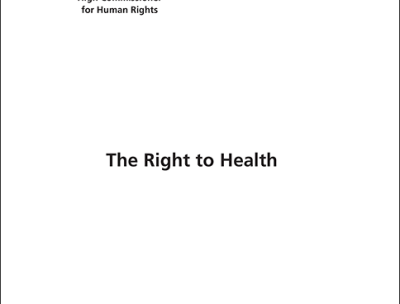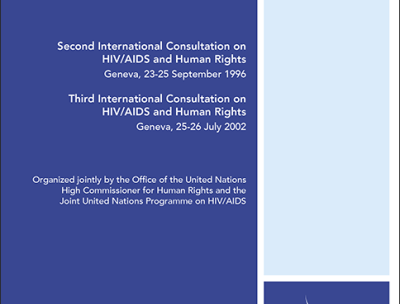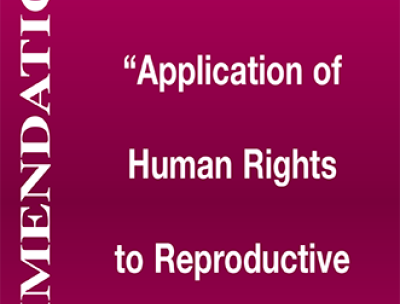Le HCDH et le droit à la santé

Comme le précise l’Observation générale nº 14, le droit à la santé est un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé, tels que :
- l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement ;
- l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains, la nutrition et le logement ;
- l’hygiène du travail et du milieu ;
- l’accès à l’éducation et à l’information relatives à la santé.
Principaux aspects du droit à la santé
Le droit à la santé suppose l’existence des éléments essentiels suivants :
- disponibilité ;
- accessibilité ;
- acceptabilité ;
- qualité ;
- participation ;
- responsabilité.
Le droit à la santé suppose également des libertés et des droits. En savoir plus sur les principaux aspects du droit à la santé et les fréquents malentendus concernant ce droit
Droit à la santé et autres droits de l’homme
Le droit à la santé physique et mentale est étroitement lié à d’autres droits de l’homme et dépend de leur réalisation. Il a des liens, par exemple, avec le VIH/sida, le handicap et les changements climatiques. Protéger le droit à la santé nécessite de faire respecter d’autres droits de l’homme tels que ceux énumérés ci-dessous.
- Le droit à la sécurité sociale : un système de protection sociale complet aide à faire face aux multiples dimensions de la pauvreté et de la précarité qui sont souvent liées à une mauvaise santé, et garantit un niveau de vie suffisant en cas de maladie.
- Le droit à l’alimentation : une alimentation saine contribue à renforcer la résilience, tandis que la malnutrition ou une alimentation inadéquate a des effets néfastes importants sur la santé.
- Le droit à l’éducation : l’accès à des informations exactes et à l’éducation à la santé permet à chacun de faire des choix sains en matière d’alimentation, de prévention, de soins et de services de santé.
Cela nécessite une approche à l’échelle de l’ensemble des pouvoirs publics et de la société afin de mettre en place des politiques de santé efficaces qui ne laissent personne de côté.
Veuillez consulter la Fiche d’information nº 31 et les autres documents clés accessibles ci-dessous pour en apprendre davantage sur les liens avec d’autres droits de l’homme, les implications pour les individus ou pour des groupes particuliers, et les obligations des États en matière de droit à la santé.
Travaux du HCDH sur le droit à la santé
Le HCDH joue un rôle important dans la promotion du droit à la santé en :
- fournissant une assistance technique et des conseils aux États et aux autres parties prenantes sur les interventions essentielles en matière de législation et de politiques ;
- encourageant l’intégration des normes relatives au droit à la santé dans les politiques, les outils et les programmes des Nations Unies ;
- établissant des partenariats avec la société civile et en plaidant en faveur du renforcement du pouvoir d’action des titulaires de droits pour qu’ils fassent valoir leurs droits en matière de santé ;
- aidant les États et les autres parties prenantes à établir les principes de santé dans une perspective axée sur les droits de l’homme ;
- renforçant les capacités des différents acteurs pour ce qui est de la relation entre santé et droits de l’homme ;
- promouvant : une action climatique fondée sur les droits ; le droit à la santé des personnes handicapées ; des approches fondées sur les droits pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles et protéger la santé de l’enfant ; et les droits économiques, sociaux et culturels des migrants.
- Note sur la couverture maladie universelle et le droit à la santé
Documents clés
Observation générale no 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative (art. 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)
E/C.12/GC/22
Observation générale no 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24), Comité des droits de l’enfant
CRC/C/GC/15
Observation générale No 14 concernant la mise en oeuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
E/C.12/2000/4
Une approche de la santé fondée sur les droits humains, HCDH/OMS (2008)
Fiche d'information No. 31: Le droit à la santé, HCDH/OMS (2008)
Derniers rapports
E/2023/74 : Droits économiques, sociaux et culturels (2023)
Dans le présent rapport, soumis conformément à la résolution 48/141 de l’Assemblée générale, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme décrit les problèmes liés à l’accès aux médicaments qui se posent dans le système actuel d’innovation pharmaceutique, les modèles commerciaux qui y sont associés et les pratiques actuelles en matière de fixation des prix. Le coût prohibitif des médicaments dans les pays pauvres comme dans les pays riches est l’une des principales raisons pour lesquelles 2 milliards de personnes n’ont pas accès aux médicaments dont elles ont besoin et des milliers de décès évitables surviennent chaque jour, ce qui soulève d’importantes questions en matière de droits humains.
A/HRC/52/56 : Garantir à tous les pays un accès équitable, rapide et universel, à un coût abordable, aux vaccins mis au point pour lutter contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) (2023)
Le présent rapport porte sur les incidences sur les droits de l’homme, y compris le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, de l’accès rapide, équitable et universel à des vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-19) sûrs, efficaces, abordables et de qualité et de leur distribution à un coût abordable, ainsi que sur les bonnes pratiques adoptées et les principales difficultés rencontrées à cet égard.
A/HRC/50/53 : Droits de l’homme et VIH/sida (2022)
Dans le présent rapport, soumis au Conseil des droits de l’homme conformément à sa résolution 47/14, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme recommande certaines mesures nécessaires pour atteindre les objectifs assignés aux leviers sociétaux que l’Assemblée générale a adoptés dans sa Déclaration politique sur le VIH et le sida : mettre fin aux inégalités et agir pour vaincre le sida d’ici à 2030 : en supprimant les cadres juridiques et les cadres d’action répressifs, en combattant la stigmatisation et la discrimination et en s’attaquant aux inégalités de genre et à la violence fondée sur le genre.
A/HRC/49/35 : Incidences sur les droits de l’homme des lacunes dans l’accès rapide, équitable et universel à des vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-19) et leur distribution à un prix abordable et du creusement des inégalités entre les États (2022)
Dans le présent rapport, établi en application de la résolution 46/14 du Conseil des droits de l’homme, la Haute-Commissaire examine les incidences sur les droits de l’homme des lacunes dans l’accès rapide, équitable et universel à des vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-19) et leur distribution à un prix abordable et du creusement des inégalités entre les États.
A/HRC/47/23 : Le rôle central de l’État dans la lutte contre les pandémies et autres urgences sanitaires et les conséquences socioéconomiques qui en résultent pour la promotion du développement durable et la réalisation de tous les droits de l’homme (2020)
Le rôle central de l’État pendant les pandémies et autres urgences sanitaires est d’élaborer une réponse sanitaire efficace tout en continuant de protéger les droits de l’homme, ce qui consiste à respecter, protéger et réaliser les droits économiques, sociaux et culturels en portant une attention particulière à la couverture médicale et à la protection sociale universelles comme éléments constants de toute stratégie de riposte, de préparation et de relèvement.
E/2019/52 : Rapport sur la couverture maladie universelle et les droits de l'homme (2019)
Dans le présent rapport, soumis en application de la résolution 48/141 de l’Assemblée générale, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme examine la manière dont le cadre des droits de l’homme, particulièrement quant à la santé et la sécurité sociale, peut contribuer à la conceptualisation et à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle.
A/HRC/38/37 : Contributions du cadre relatif au droit à la santé à la mise en œuvre et à la réalisation effectives des objectifs de développement durable liés à la santé (2018)
Dans le présent rapport, soumis en application de la résolution 35/23 du Conseil des droits de l’homme, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme examine les contributions du cadre relatif au droit à la santé à la mise en œuvre et à la réalisation effectives des objectifs de développement durable liés à la santé.
A/HRC/34/32 : Santé mentale et droits de l’homme (2017)
Le présent rapport, demandé par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 32/18, recense quelques-uns des principaux problèmes rencontrés par les usagers des services de santé mentale et les personnes présentant un trouble mental ou un handicap psychosocial, tels que la stigmatisation et la discrimination, la violation des droits économiques, sociaux et autres, le déni d’autonomie et la privation de la capacité juridique.