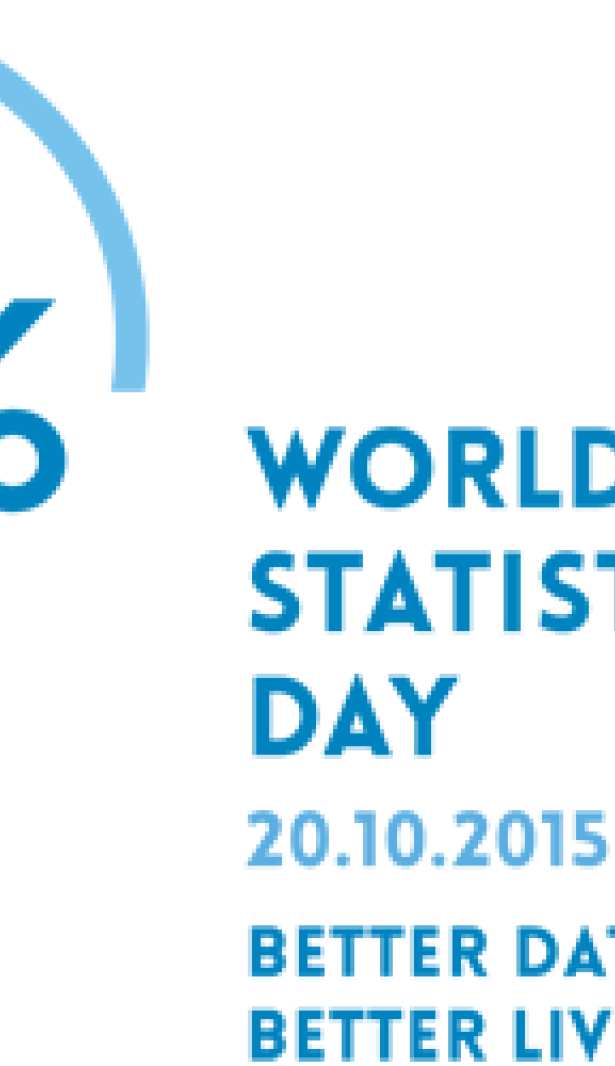De meilleures données pour une vie meilleure
20 octobre 2015

La célébration de la cinquième Journée mondiale de la statistique, le 20 octobre 2015, a lieu au moment où les chefs d’État du monde entier ont convenu d’une série d’objectifs destinés à assurer un développement durable pour tous, partout sur la planète. Ils appellent à mettre en œuvre ce programme, à l’horizon 2030, en adoptant le mot d’ordre suivant : ne laisser personne de côté.
Une approche orientée sur les droits de l’homme en matière de données et de statistiques – c’est-à-dire une approche qui détecte les formes multiples et convergentes de discrimination à l’égard d’un groupe particulier grâce à des données ventilées – peut s’avérer particulièrement utile pour éclairer les décisions qui devraient améliorer notre vie. Les difficultés que présente la collecte de données sur les groupes marginalisés s’accentuent encore lorsque ces groupes sont « juridiquement» invisibles, c’est-à-dire lorsque leur existence n’est pas reconnue, voire considérée comme illégale, par l’État.
À l’occasion d’une réunion organisée par le HCDH à Genève afin de recenser les pratiques exemplaires concernant les droits de l’homme et la collecte de données, M. Smarajit Jana a évoqué son expérience en qualité de Conseiller principal du Comité Durbar Mahila Samanwaya, un collectif de travailleurs et travailleuses du sexe basé à Calcutta (Inde).
L’objectif de son organisation est de faire en sorte que les travailleurs du sexe soient reconnus comme des travailleurs à part entière en Inde et puissent bénéficier, tout comme leurs enfants, des prestations prévues par les programmes nationaux de développement, notamment en ce qui concerne la santé, l’éducation, le logement et l’accès au crédit par l’intermédiaire d’établissements financiers.
Le collectif a vu le jour en 1992, lorsqu’un programme de prévention du VIH et du sida a été lancé à Calcutta. Les travailleurs et les travailleuses du sexe ont joué un rôle central dans le programme, car ils et elles aspiraient à mettre fin à la stigmatisation et à la violence subies par les membres de leur profession, à recouvrer leur dignité et à s’assurer une place, ainsi qu’une voix, au sein de la société. Leur expérience négative, concernant la mauvaise utilisation des données collectées à leur sujet par le passé, avait amoindri leur confiance à l’égard des milieux de la recherche.
« Le collectif représente plus de 60 000 travailleurs et travailleuses du sexe de l’État du Bengale occidental », explique M. Jana. « En Inde, plus de 90 pour cent des travailleurs et travailleuses du sexe ont des enfants et ils ou elles se préoccupent avant tout de l’accès de leurs enfants à l’enseignement et à une formation professionnelle débouchant sur un métier. Petit à petit, ils ont conçu des programmes pour permettre à leurs enfants d’être considérés à l’égal de n’importe quel autre citoyen indien. »
Le programme de lutte contre le VIH et le sida est administré par 700 personnes, dont 85 pour cent sont issues du collectif. Celles-ci gèrent aujourd’hui 49 dispensaires qui offrent des services et des conseils en matière d’hygiène sexuelle et de santé de la procréation.
« Les autorités ont bien compris que ce collectif était pleinement en mesure de mener à bien le volet développement du programme, mais aussi qu’il pouvait recueillir par lui-même, avec une grande efficacité, des informations et des données de qualité, en raison de la confiance que lui accordait la communauté », ajoute M. Jana. « Certains membres du collectif siègent désormais dans des organes de direction nationaux, où ils prodiguent des conseils sur l’amélioration du suivi et de l’évaluation des programmes. »
Freek Spinnewijn, Directeur de la FEANTSA, une fédération européenne d’associations procurant des abris et des logements temporaires aux sans domicile fixe, tente de sensibiliser les décideurs et l’opinion publique à la situation des sans-abri et de faire pression sur l’Union européenne pour que celle-ci applique des politiques adéquates, alloue des fonds et entreprenne des recherches pour la cause des sans-abri.
« Le sans-abrisme est invisible parce qu’il n’y a pas de données au niveau européen. Bien que dans la pratique, on voie des sans-abri dans toutes les villes européennes, il n’y a pas trace du sans-abrisme dans l’appareil statistique de l’Union européenne et c’est là le plus gros problème ; c’est pour cela que la politique en la matière est peu développée au niveau européen. »
M. Spinnewijn souligne qu’il n’existe pas de chiffres globaux sur le sans-abrisme ou de données de profil à l’échelon européen, alors que dans les pays, il y a pléthore de données. Le sans-abrisme, selon la définition qu’en donne l’Union européenne, se résume aux personnes qui vivent dans la rue et dans les foyers pour sans domicile fixe et c’est en fonction de ces critères qu’elle le mesure. Cette vision étroite explique les résultats surprenants des recensements : celui de 2011, par exemple, a montré qu’il n’y avait pas de sans-abri dans 12 pays européens. Des sous-dénombrements énormes qui excluent les sans-abri des objectifs fixés par l’Union européenne en matière de lutte contre la pauvreté.
M. Spinnewijn a été chargé d’étudier les moyens d’utiliser plus efficacement les données recueillies par des prestataires de services individuels et a élaboré une méthodologie qui reste au stade expérimental. Son organisation parle d’un « profil » du sans-abrisme : une définition harmonisée comprenant non seulement les sans-abri visibles mais aussi les personnes qui vivent sans des établissements de soins ou dans des structures pénitentiaires, les gens qui habitent dans des logements non conventionnels et les sans-abri hébergés à titre temporaire par des amis ou des membres de leur famille, par exemple.
« Une extrapolation peut nous amener à penser qu’il y a tous les jours sans exception 450 000 personnes sans abri en Europe », révèle-t-il.
20 octobre 2015