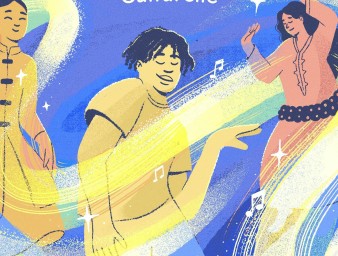Pour une protection efficace des droits des migrants au Niger
19 décembre 2019

Fatou*, une Guinéenne de 18 ans, aspirait à une vie de dignité, loin de la pauvreté : « Je voulais juste quitter le pays. On ne peut pas rester en Guinée, il y a trop de problèmes ». Nwankwo*, un jeune Nigérian de 30 ans, ambitionnait de rejoindre l’Europe : « Je suis programmateur en informatique. Je voulais me donner un meilleur avenir ».
Rackets, arrestations, détentions, déportations
Comme pour la majorité des ouest-africains qui décident de prendre la route de la migration, les motivations de Fatou et Nwankwo étaient diverses et très complexes. Si pour Nwankwo elles étaient principalement liées à des opportunités économiques et éducatives limitées, pour Fatou, ce sont tant la dégradation de la situation environnementale et sanitaire de son pays d’origine que des problèmes de famille qui l’ont convaincu de faire le choix de la migration.
De la même manière que les nombreux migrants en transit, ils ont connu, aussi bien de la part des acteurs privés que de représentants de l’Etat, les rackets à chaque checkpoint, les arrestations et détentions arbitraires, les déportations mais aussi les tortures et la dégradation de leur santé physique et mentale. Ces abus et violations des droits de l´homme sont commis le plus souvent en toute impunité. Les migrants sont souvent contraints de dépendre de « facilitateurs », pour se loger, pour se soigner et pour trouver du travail, du fait de leur crainte d’être arrêtés s’ils recouraient à des filièresrégulières pour leurs besoins.
« Au Mali, j’ai travaillé, les policiers ont pris mon argent et m’ont torturé. Au Burkina Faso, je n’avais pas l’argent pour payer le gendarme, j’ai fait 24 jours en prison. Au Niger, j’ai travaillé trois mois pour pouvoir aller en Europe. Je suis allée en Libye où j’ai fait trois mois en prison. Ils nous ont torturés. Ma famille a payé et je suis sortie », se rappelle Fatou. « Ils nous ont ramené à côté de la mer, nous étions 130 personnes. On a eu un accident dans la mer. Certains sont morts, avec d’autres j’ai été sauvée. J’ai fui pour l’Algérie. Là-bas, les militaires m’ont attrapée et m’ont abandonnée dans le désert à Tamanrasset. J’ai pu rejoindre Assamakka et de là, avec d’autres personnes, nous sommes venus en voiture jusqu’à Arlit. Pendant le rapatriement, ils te prennent ton argent».
Nwankwo s’explique : « J’ai quitté Lagos pour l’Etat de Kano, au nord du Nigeria, en voiture. De là, je suis parvenu jusqu’à Agadez, via Zinder et le village de Memouja. J’ai payé un chauffeur pour y arriver. J’ai aussi payé un chauffeur à partir d’Agadez pour me rendre en Libye, où j’ai passé quatre jours dans le désert. Nous étions un groupe de 21 personnes, nous n’avions ni eau ni nourriture. Des libyens nous ont vendus. J’ai passé 11 mois en prison, on nous frappait. Un ami a finalement payé pour ma libération et m’a aidé à rejoindre Agadez ».
Comme pour beaucoup de ces migrants ayant emprunté des parcours différents pour essayer d´atteindre l´Europe, Fatou et Nwankwo sont passés par le Niger et sont revenus, malgré eux, au Niger. Ce pays de transit est devenu une sorte de sentinelle contribuant à réduire les mouvements de population vers l’Afrique du Nord et la Méditerranée.
Niger, zone de transit des migrants d’Afrique subsaharienne
Véritable porte de l’Afrique de l’Ouest vers le Sahara, le Niger, et la région d’Agadez en particulier, ont historiquement constitué des lieux d’échanges, de marché et de communication pour les populations de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest qui y vont et viennent légalement, dans le cadre du traité de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest).
« Les gens se sont faits beaucoup d’argent, avec l’afflux de migrants ici, de l’ordre de 2 à 3000 chaque semaine. Tout le monde avait du travail, les marchés étaient bouillonnants, l’argent circulait », souligne Bachir Amma, le Président de l’association des ex-prestataires de migration à Agadez et ancien passeur de 2001 à 2016.
La loi 2015-036 contre le trafic illicite des migrants a modifié la donne. Cette loi, mise en application en 2016, vise à mettre fin à la circulation des populations vers la Libye et l’Algérie. Elle a cependant aussi entravé la mobilité des étrangers comme des nationaux sur le territoire nigérien. Bachir s’en explique : « Des gens avaient du travail, mais on leur dit maintenant que leur travail est illicite. Que voulez-vous qu’ils fassent ? Quand après un an, deux ans, rien n’a été fait pour vous aider dans une reconversion, la majorité des ex-passeurs ont été amenés à reprendre leurs anciennes activités de passeur. Quitte, maintenant, à risquer leurs vies et celles des migrants ».
Cette loi 2015-036 a, en effet, entrainé les migrants à choisir des routes migratoires vers des zones de plus en plus dangereuses, ce qui a eu pour conséquence d’augmenter les risques pour les migrants d’êtres victimes de violations des droits de l’homme.
« Depuis l’application de cette loi, il y a eu beaucoup de morts et de gens abandonnés dans le désert. Avant, quand un migrant arrivait à Agadez, il s’installait dans les ghettos (zone où les migrants résident en attendant le départ vers l’Afrique du Nord) et avait le droit d’aller où il voulait. Aujourd’hui, quand un migrant arrive, il doit rester enfermé dans la maison du passeur jusqu’à son départ », poursuit M. Amma.
Le projet PROMIS pour une protection efficace des droits des migrants
C’est dans ce contexte qu’émerge, au Niger, le projet PROMIS (« Protection des migrants: justice, droits de l'homme et trafic de migrants »), une initiative conjointe du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH) et de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Elle fut lancée en 2016 et vise à renforcer la lutte contre le trafic illicite de migrants fondée sur les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest.
Dès la naissance de ce projet, opérationnel depuis novembre 2018, le HCDH a œuvré à renforcer les capacités du Niger non seulement pour développer une réponse à ce trafic illicite, mais aussi pour répondre efficacement aux violations des droits de l’homme en lien avec la migration irrégulière.
Pour Andrea Ori, chef du bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du HCDH à Dakar, il s’agit de « passer d’une perception des migrants comme un fardeau à une perception des migrants en tant qu'êtres humains ».
Les interventions du HCDH, à travers ce projet, permettront de renforcer la protection des droits des migrants et leur accès à la justice, et de prévenir ou de réduire ces expériences dramatiques, traumatisantes et illégales vécues par des migrants tels que Fatou et Nwankwo. Le HCHD poursuivra la réalisation de missions d'évaluation des droits des migrants, l´assistance technique et juridique aux institutions nationales des droits de l'homme, aux institutions parajuridiques et juridiques ainsi qu’aux acteurs de la société civile, mais aussi l´octroi de subventions aux organisations de la société civile qui défendent les droits des migrants.
Parce que, les droits des migrants sont touchés dès qu’ils empruntent la route pour arriver à Agadez. « Ils sont menacés et rackettés sur les routes par la police. Arrivés à Agadez, ils n’ont pas le droit de sortir dehors. Que fait-on de leur droit de circuler librement et en sécurité ? Ils sont pourtant chez eux, dans l’espace CEDEAO », rappelle M. Amma.
Il est toutefois important de préciser que si le projet PROMIS constitue une « approche innovante contre le trafic illicite de migrants se basant sur les droits de l'homme », il est nécessaire de poursuivre une approche globale de la gouvernance migratoire fondée sur les droits de l'homme, qui place les migrants au centre des lois et des politiques migratoires. Une approche fondée sur les droits de l'homme aboutit à des résultats meilleurs et plus durables pour les migrants et les communautés d'origine, de transit et de destination. Avec l'adoption du Pacte mondial sur les migrations, les États membres ont approuvé une feuille de route pour une gouvernance des migrations internationales fondée sur les droits de l'homme.
Nwankwo est décidé à retenter sa chance : « J’essaierai encore de voyager dans un autre pays, dans le futur. Mais je ne veux plus prendre ce genre de risques dans ma vie. » Fatou, qui a gardé des séquelles psychologiques de son premier essai, souhaite désormais rentrer chez elle : « Je voulais aller à l’étranger. Maintenant, je veux rentrer chez moi, je n’ai rien mais je vais voir ce que je peux faire. On a besoin de changement. Le gouvernement doit penser à la jeunesse qui souffre ».
****
* Les prénoms ont été changés.
19 décembre 2019