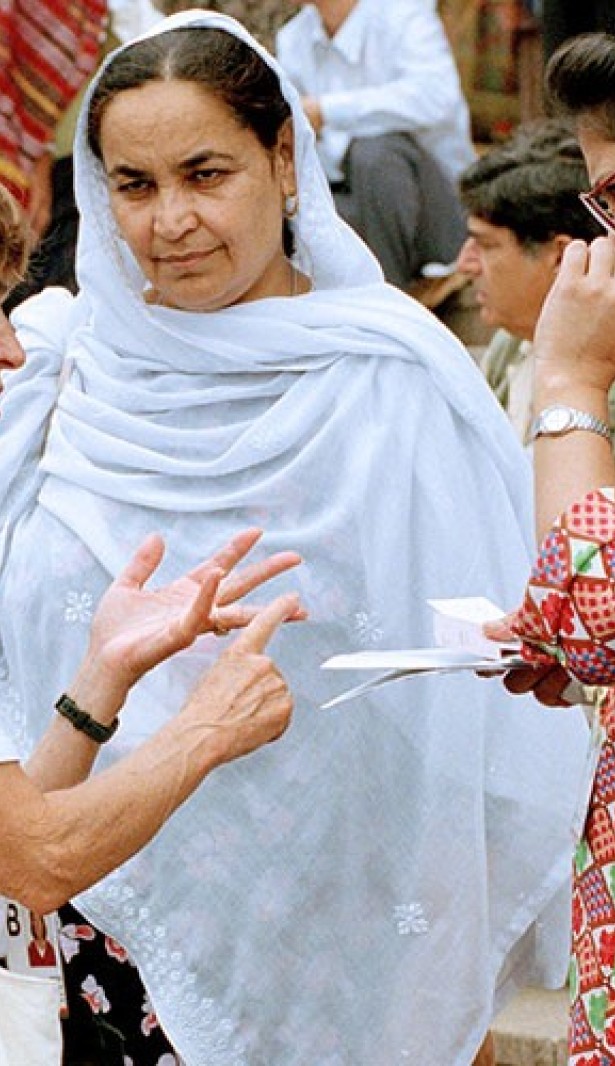Le point sur 25 ans d’actions en faveur des droits des femmes
06 mars 2020

En dépit de la révolution engendrée par l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing il y a vingt-cinq ans, « l'heure n'est plus à la complaisance », a mis en garde Michelle Bachelet, Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.
Michelle Bachelet a pris la parole lors d'une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève pour faire le point sur les progrès accomplis ces 25 dernières années en faveur de l'égalité des sexes.
Elle a souligné que plus de 140 pays sont désormais en mesure de garantir l'égalité des sexes dans leur constitution et que dix pays ont promulgué des lois contre le harcèlement sexuel. En outre, le pourcentage de femmes ayant un emploi rémunéré a augmenté et les pays disposent de beaucoup plus de données sur les violences commises à l'égard des femmes.
Cependant, Mme Bachelet a indiqué que les risques de retours en arrière sont croissants. « Nous assistons à la résurgence de discours contre l'égalité des sexes fondés une discrimination vieille de plusieurs siècles », a-t-elle expliqué. « Nous devons résister à toute contestation d'une affirmation durement acquise, à savoir que les droits des femmes sont des droits humains – dans leur universalité et indivisibilité, et pour toutes les femmes, dans leur pleine et libre diversité », a-t-elle ajouté.
La Conférence de Beijing a permis de redresser la barre
Bandana Rana, aujourd'hui Vice-Présidente du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, se souvient avoir assisté à la quatrième Conférence sur les femmes en 1995 en tant que jeune journaliste népalaise et avoir été bouleversée par ce qu'elle a décrit comme « l'euphorie et la force d'un mouvement collectif » qui a changé sa vie. Elle était déterminée à défendre les femmes et les filles exploitées et victimes de discrimination, et rien n'a changé depuis.
« Le Programme d'action de Beijing est un cadre de référence solide et novateur qui m'a guidée tout au long de mon parcours en tant que militante pour la paix et l'égalité des sexes, et 25 ans plus tard, il est plus pertinent que jamais pour protéger les droits humains et l'égalité des sexes », estime Mme Rana.
Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes aide les pays à mesurer leurs progrès en la matière en établissant un dialogue constructif et en émettant des recommandations. À travers ce mécanisme, Bandana Rana se rend compte des liens qui existent entre les engagements pris à Beijing et les changements sur le terrain.
« Grâce à son cadre législatif, le Comité aide les États Membres à renforcer leur volonté d'établir leurs responsabilités pour bâtir un monde sans violence, stigmatisation, ni stéréotypes ; où les mariages d'enfants n'existent pas ; où l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes est respectée ; et où une paix et une sécurité durables sont assurées pour tous », indique-t-elle.
« Nous devons créer des institutions efficaces et allouer les ressources nécessaires pour que les femmes puissent exercer leurs droits. Nous devons être à l'écoute des femmes et des jeunes filles. Nous devons répondre aux différents besoins des femmes dans le secteur public comme dans le secteur privé », ajoute-t-elle.
La lutte pour l'égalité des sexes, un véritable « champ de bataille »
Magalys Arocha Dominguez, experte en matière de droits de l'homme et d'égalité des sexes, qualifie la Conférence de Beijing et ses accords de « champ de bataille ».
« Plusieurs questions ont été prises en otage par les forces les plus rétrogrades et réactionnaires : les ressources économiques, les droits en matière de sexualité et de procréation, les conflits armés. La notion d'égalité des sexes ainsi que la diversité sexuelle et familiale, entre autres, ont fait l'objet de vifs débats, menés sous pression et face aux menaces », explique Mme Dominguez.
Vingt-cinq ans plus tard, à Genève, Arocha Dominguez demande à ce que davantage de stratégies et de mesures soient mises en place pour éliminer les pratiques néfastes, la suprématie masculine et les stéréotypes sexistes qui sont la base de toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes, et des distinctions faites entre les femmes elles-mêmes.
« L'égalité des femmes ne peut pas être réalisée de manière isolée ; elle nécessite des changements structurels au sein des sociétés », ajoute-t-elle.
Aujourd'hui, plus de filles vont à l'école que jamais auparavant et les écarts entre les sexes dans le système éducatif se resserrent, souligne Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directrice exécutive d'ONU-Femmes. Elle explique également que moins de femmes meurent durant l'accouchement, car un plus grand nombre d'entre elles peuvent accéder à des soins de maternité. Elle regrette toutefois le manque d'égalité réelle des femmes, en particulier sur le plan économique ; la persistance de la violence à l'égard des femmes et des filles ; et la dégradation écologique qui place les femmes au premier rang des mouvements environnementaux.
Phumzile Mlambo-Ngcuka espère que le Forum Génération Égalité, qui se tiendra cette année au Mexique et en France, sera l'occasion de lancer six coalitions d'action qui permettront d'obtenir des résultats concrets et décisifs pour les femmes et les filles au cours des cinq prochaines années.
6 mars 2020